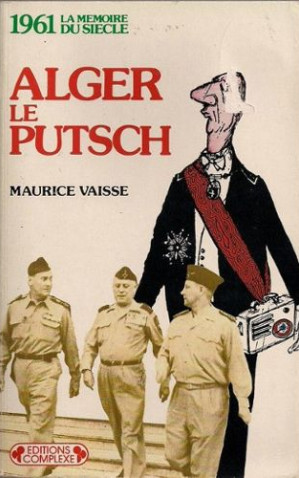
1961 Alger Le Putsch
Maurice VAISSE
Dans la nuit du 21 au 22 avril 1961, l'armée s'empare du pouvoir à Alger. A la tête des unités insurgées, se trouvent quatre des plus prestigieux anciens chefs de l'armée, les généraux
Challe, Jouhaud, Zeller, auxquels se joint peu après le général Salan. Ils visent au rassemblement de toute l'armée française pour maintenir "l'Algérie française" et empêcher que les
négociations d'Evian avec le F.L.N. ne transforment en défaite politique leur victoire militaire.
Pour la troisième fois en 3 ans, Alger entre en insurrection contre Paris. Cette "fronde" qui faillit faire basculer le pouvoir gaulliste est organisée par des généraux qui invoquent
les mêmes principes opposés naguère par de Gaulle au maréchal Pétain en 1940. Ce n'est pas simplement une opération au service des pieds-noirs qui s'opposent à la décolonisation: les
putschistes prétendent être en avance sur leur temps. Ils ont glâné la grloire militaire sur tous les champs de bataille et n'ont pas cessé de se battre depuis 1939. ILs ont tous
fait l'Indochine et ont cru y comprendre le sens de leur combat. Ils préconisent une lutte acharnée contre le F.L.N., une action anticommuniste et une nouvelle politique économique
et sociale. Pour le général Challe et les colonels, perdre l'Algérie, c'est perdre une bataille décisive qui oppose l'Est à l'Ouest. Le fossé se creuse chaque jour un peu plus entre
le général de Gaulle - revenu au pouvoir pour "sauver l'Algérie', et dont la politique tend de plus en plus vers "l'Algérie algérienne" - et de nombreux cadres de l'armée.
Le 22 avril, le putsch éclate. Le spectre de la sécession, voire de la guerre civile secoue Paris. Mais l'armée qui semblait neutralisée est en réalité en proie à une profonde crise
de conscience. Le contingent se réveille. L'oreille rivée à leur transistor, les appelés écoutent les ordres venus de Paris, et refusent de marcher. L'opinion métropolitaine - et
internationale - se mobilise très vite contre les putschistes. Le pouvoir légal ne chancelle pas: prenant la parole à la télévision, le général de Gaulle, revêtu de son uniforme militaire,
sait trouver les mots et le ton justes pour regrouper les énergies et apparaître une fois de plus comme le "sauveur".
Trois jours plus tard, le putsch est fini. Toute l'Algérie est aux mains des forces loyalistes. Challe et d'autres officiers se rendent. Salan, Jouhaud, suivis d'autres
"soldats perdus" vont continuer leur combat au sein de l'O.A.S., négatif sanglant du putsch.
Les répercussions sont à la mesure de l'événement: de Gaulle a désormais les mains libres; les pieds-noirs sont abandonnés à l'O.A.S.; les pourparlers avec le G.P.R.A. s'ouvrent à
Evian. La voie vers l'indépendance de l'Algérie est tracée, dans une atmosphère tendue et sanglante. L'armée française est profondément ébranlée par l'aventure. La grande muette a
enfreint la règle d'or du silence. La répression s'abat. La méfiance et l'amertume règnent. L'armée classique est morte. L'armée technicratique de la force de frappe va naître.
Première parution : 1983
ISBN : 2-87027-115-8
Editeur : Complexe (1983)
Collection : La Mémoire du Siècle (30)